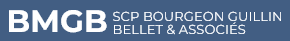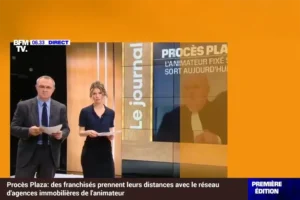Tel est le cas des quatre arrêts rendus le 3 mars 2022 par la Cour d’appel de Grenoble. Quatre franchisés exploitant leur activité dans le secteur des soins esthétiques obtiennent gain de cause en ayant démontré qu’ils avaient été trompés sur toute la ligne par un franchiseur peu scrupuleux.
Soigneusement motivées, ces quatre décisions de justice délivrent une leçon de droit que tous les franchiseurs devraient méditer: on ne badine pas avec l’exigence de transparence!
Cette affaire illustre parfaitement l’importance de la vigilance pour ceux qui envisagent d’être franchisé. La transparence et l’honnêteté sont des piliers essentiels pour établir une relation de confiance entre franchisé et franchiseur. Sans ces éléments, le risque de malentendus ou de tromperies est amplifié, ce qui peut avoir des conséquences graves sur la viabilité de l’activité franchisée.
C’est du reste aussi une leçon de bon sens : il n’est nul secret que le temps n’ébruite…
Le Contrat de Franchise
Ce modèle de contrat s’applique dans tous les secteurs et dans tous les métiers. Avec le conseil du cabinet BMGB, restez vigilant avant de signer un contrat qui engage sur plusieurs années…
Annulation du contrat de franchise, 3 exemples de tromperies
Ces quatre décisions invitent en effet à examiner trois types de tromperies.
La tromperie sur le titre du contrat
D’abord, la Cour d’appel rappelle cette grande vérité qu’aucun contractant ne saurait oublier : le titre d’un contrat n’a pas la moindre force contraignante. Ce titre ne lie pas le juge qui doit s’en remettre à ce qu’ont voulu faire les parties, c’est tout. Il importait peu en l’espèce que le contrat s’intitule «licence de marque». Dès lors qu’il prévoyait la transmission d’un savoir-faire et une obligation d’assistance, c’était un contrat de franchise. Au demeurant, cela n’avait pas d’incidence dans la mesure où la tête d’un réseau est tenue d’une obligation de transparence toutes les fois qu’elle met à disposition de ses partenaires des signes distinctifs de ralliement de la clientèle et qu’elle exige d’eux une exclusivité ou une quasi-exclusivité, ce qui était bien le cas ici.
La tromperie sur la rentabilité de l’activité
Ensuite, et surtout, la Cour d’appel prend soin de relever l’ensemble des lacunes et des travers du document d’information qui avait clairement pour but d’induire en erreur les candidats.
Pas d’état local du marché par exemple ! L’annexe consacrée à cet état était restée vierge. Or, si le franchiseur n’est pas tenu de réaliser une étude de marché, il est bien tenu, rappellent les magistrats, de présenter un état du marché local du produit concerné. La Cour va d’ailleurs plus loin en précisant qu’il revient au franchiseur de communiquer «des données spécifiques au lieu d’implantation envisagé tels le nombre d’habitants, la composition de la clientèle selon des critères pertinents par rapport à l’objet de la franchise, la liste des concurrents dans la zone d’implantation et les performances du réseau au regard de celles des concurrents». Certes, il peut en aller autrement lorsque le candidat connaît très bien la zone. Mais la Cour prend soin de le relever : c’est au franchiseur de le montrer, ce qu’il ne faisait pas ici. Mais ce n’est pas tout. La présentation de l’évolution et de l’expérience professionnelle du franchiseur était tendancieuse en ce qu’elle passait sous silence de précédentes expériences malheureuses. Par ailleurs, alors que le document d’information précontractuelle doit présenter le réseau d’exploitants, il «ne mentionnait ni le nom, ni l’adresse des entreprises établies en France, ni leur mode d’exploitation, ni la date de conclusion ou de renouvellement de leurs contrats», de sorte qu’il ne permettait pas au candidat de prendre contact avec les franchisés du réseau pour recueillir leur avis et des informations sur le service proposé, leur expérience professionnelle et la pérennité de l’activité.
Tout était fait pour que les franchisés se méprennent sur la rentabilité de leur future activité. Le franchiseur avait même intégré dans le document d’information remis aux franchisés des chiffres prévisionnels irréalistes. Dès lors qu’aucune faute de gestion ne pouvait être reprochée aux franchisés, l’écart important avec les chiffres réalisés par ces derniers suffisait à établir la faute du franchiseur.
La tromperie sur la méthode franchisée
Enfin, les quatre arrêts de la Cour d’appel de Grenoble mettent en avant une donnée intéressante plus inhabituelle. Le franchiseur avait en effet bâti son concept sur une méthode dont la légalité était douteuse. Or, la seule existence d’un doute sur cette légalité ne pouvait être acceptée. Le franchisé entend exploiter un concept conforme à la loi, c’est bien le minimum. Qu’il existe un simple doute sur la question, son consentement n’aura pas été donné de manière éclairée, ce qui justifie l’annulation du contrat de plus fort.
Il est crucial pour chaque franchisé de s’assurer que le concept proposé par le franchiseur est non seulement rentable, mais aussi conforme à la législation en vigueur. Cela permet d’éviter des litiges juridiques qui pourraient survenir en raison d’une méthode non validée légalement, assurant ainsi une exploitation sereine de la franchise.
Il faut louer le pragmatisme de ces quatre décisions qui reposent sur une approche concrète de la franchise, soucieuse des réalités économiques.